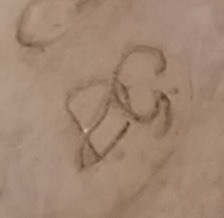Biographie
Daria Gamsaragan est une artiste sculpteur et médailliste et décédée à Paris, à son domicile Square Henri Delormel, 14ème arrondissement le 1er Mars 1986. Elle est également écrivaine sous le pseudonyme d’Anne Sarag.
Père : Armenag Gamsaragan
Mère : Galinig Djabourov
Fratrie : Aram Gamasaragan, Yervant Gamsaragan, Ardemis Dora Gamsaragan
Epouse : mariée à Imre Gyomai (de son vrai nom Hovhannes Wayberger) le 6 Juin 1926 à Alexandrie (Egypte), divorcée le 22 Décembre 1937 à Alexandrie (Egypte)
Nationalité : égyptienne, naturalisée française par Décret du 6 Octobre 1967
Daria Gamsaragan, de son vrai nom Ardemis Dora Gamsaragan, est née à Alexandrie (Egypte) le 24 Avril 1902 dans une famille d’origine arménienne, venue de Constantinople (actuel Istamboul). Les Gamsaragan sont une lignée de grands généraux d’origine arménienne qui se sont révélés par leurs exploits dans l’armée russe. Certains avaient le titre de prince. Le grand père de Daria, Khatchadour Gamsaragan et ses deux frères ont quitté Erevan (Arménie) dès leur plus jeune âge pour s’installer à Constantinople afin d’explorer des possibilités de travail. Leur famille avait été assaillie par de grandes difficultés dans le Caucase et ces déboires les ont contraints à quitter leur pays natal. Honnête et travailleur, Khatchadour Gamsaragan a rapidement progressé dans le commerce du tabac, pour occuper une position de choix en Turquie, avant l’instauration de la Régie Ottomane des Tabacs. Il a fondé un établissement de tabac à Izmir, qui devint une maison importante connue sous le nom de « L’embarcadère des pins » en turc. Il fut ainsi un fournisseur officiel de tabac et cigares du Palais Impérial, principalement au temps du sultan Mourad.
Après la mort de Katchadour Gamsaragan, ses deux fils, Armenak et Dikran Gamsaragan, quittent la Turquie pour s’installer en Egypte en 1894 et poursuivre dans la spécialité de leur père. Ils fondent une usine à Zagazig. L’Histoire est contée par Vahan Zartarian dans « Mémorial (1512-1933) des biographies d’arméniens illustres, MÉMORIAL, N° 43-45 tome 5, 1936 », cahier de 16 pages. Avant son départ pour l’Égypte Dikran Gamsaragan avait publié à Constantinople en 1888, à l’âge de 22 ans, un roman considéré à l’époque comme un chef d’œuvre littéraire, « La fille de l’instituteur ». Admirateur d’Alphonse Daudet, d’Émile Zola et de Victor Hugo, il avait aussi publié des articles à leur sujet dans la Revue « Louys » [La lumière], avant ce roman qui lui apporta la notoriété, avec le style nouveau qu’on pouvait appeler « réaliste », proche du naturalisme de Zola par exemple.
Armenak va prospérer dans le négoce de tabac. Devenu Armenak Bey, il est une figure prépondérante au sein de la communauté arménienne d’Egypte, participant généreusement aux associations caritatives ; il est membre fondateur de l’Eglise Sainte Croix de Zagazig, également donateur de la prestigieuse école Victoria College à Alexandrie. Armenak Bey fut aussi un collectionneur avisé de céramiques d’art islamique, d’antiquités et de tapis, une référence pour les collectionneurs d’aujourd’hui.
Du côté maternel, la mère de Daria est Galinig née Djabourov. Galinig a eu elle aussi une histoire compliquée. Dans ses mémoires, non publiées, Daria évoque l’histoire de sa mère et sa grand-mère maternelle n’avait pourtant pas connue.
« L’amour dont ma mère entourait la mémoire de sa mère était tel qu’elle me l’avait communiqué et cette grand-mère que je n’ai pas connue m’était devenue aussi chère, aussi proche qu’elle-même. »
La fratrie de la grand-mère comprenait quatre filles. Leur père était ébéniste.
« Il n’était probablement qu’un pauvre menuisier, mais … il aimait travailler le bois, il décorait ses meubles de motifs floraux et même de figures animales…Les artisans de cette époque étaient chichement payés, les revenus de la famille étaient modestes ». La famille de la grand-mère vivait à Kadiköy (la rive asiatique de Constantinople). Depuis cet aïeul ébéniste jusqu’à la mère de Daria, « quatre générations y naquirent et y vécurent entourés de leur amis, l’amitié étant héréditaire aussi. Dans cette maison, les fenêtres étaient garnies de pots de réséda et de bégonia, une maison à plusieurs étages, un petit jardin intérieur où trônait un magnifique figuier. »
Daria décrivait ainsi la maison natale de sa mère Galinig.
Takui, la grand-mère de Daria, fut mariée à seize ans à un vieux monsieur de santé fragile. Au bout de deux ans, Takui perdit son mari et aussi l’enfant qu’elle en avait eu de lui. Passée la période de deuil réglementaire, on se dépêcha de remarier Takui à un homme, Djabourov (on ignore son prénom) originaire de Smyrne où était présente une grande colonie grecque.
« Prospères et prépondérants, les grecs étaient les vrais maîtres de la ville et les arméniens avaient acquis une légèreté, une joie de vivre qu’ils avaient perdues dans la métropole impériale. »
Le grand-père Djabourov semble avoir été « un gai luron » qui aimait avant tout le boire le manger et la compagnie de joyeux compères. C’était un homme joyeux, auprès duquel Takui dut vivre les années les plus heureuses de son existence. Il mourut jeune, laissant quatre enfants en bas âge, qu’elle dut élever seule, sans le secours de personne. Takui se mit à travailler dans un atelier de broderie partant à l’aube pour arriver à l’autre bout de Constantinople. Elle travaillait à la limite de ses forces pour cacher à ses enfants les difficultés matérielles dont la famille était assaillie. Le frère ainé de Galinig, Bedros Djabourov, commença à travailler dès qu’il fut en âge et s’occupa ainsi de Galinig comme un père. L’entente, la tendresse régnaient dans leur maison, les enveloppant d’une telle atmosphère de bonheur que Galinig en fut imprégnée toute sa vie.
L’histoire des Djabourov, du côté de Bedros, est publiée sur : SAGA DJABOUROV – Une maison commerciale de grande exception, fondée à Bucarest dès 1870
Revenons à la fratrie de Daria. Galing et Armenak ont eu ensemble trois enfants : Daria est la plus jeune de la fratrie, seize ans la séparent de son frère ainé Aram Gamasaragan et dix ans de l’autre frère Yervant Gamsaragan. Elle nait à Alexandrie et vit son enfance dans une maison familiale, à Bulkeley (appelée Bolky aujourd’hui) une banlieue d’Alexandrie, face à la mer, entourée de l’immense affection de ses parents, une maison dont la « fraicheur a le goût de la mangue glacée » comme elle l’écrit dans ses mémoires. Son univers est un jardin avec « un bassin où des grenouilles bavardent sans cesse ».
Dès son plus jeune âge, elle reçoit une éducation conforme aux usages de l’époque dans les familles aisées : nourrice grecque, gouvernantes anglaises ou françaises. Elle apprend à s’exprimer dans ces trois langues avec beaucoup d’aisance qu’elle gardera toute sa vie. L’arabe, l’arménien et parfois le turc sont des langues qui lui sont aussi familières. Les familles Gamsaragan et Djabourov se retrouvent en été au début des années 1900, à Yakajik au bord de la mer en Turquie ou Tashdelen, où se trouve une source d’eau réputée. La famille Gamsaragan séjourne aussi régulièrement en Europe les mois d’été. « Les préparatifs du voyage en Europe commençaient dans la famille au début du mois de mai et le séjour en Europe durait jusqu’en octobre » raconte Daria.
Daria ne se voit pas comme une bonne élève. Elle change souvent d’établissement, n’est pas très disciplinée, mais ces lieux qu’elle fréquente sont pour elle l’occasion de sortir du cocon familial et de se mélanger à d’autres enfants de son âge.
« Vivant aux confins de l’imaginaire et du rêve dans la grande maison au bord de la mer j’étais habitée par les signes et les symboles ».
Daria commence à écrire en français dès ses 13 ans des cahiers remplis de poésies et de nouvelles qu’elle a imaginées. Installée plus tard au 15 rue Ross, à Saba Pacha, dans la nouvelle résidence familiale, la riche bibliothèque de ses parents est sa première source de lectures passionnantes d’auteurs classiques français et anglais. Daria réussit son baccalauréat en 1924, au Lycée Français d’Alexandrie.
Les solides amitiés nées à Alexandrie dans sa jeunesse avec les familles Aghion et Jabès sont restées vives malgré les années et les bouleversements intervenus tout au long de leurs vies. La rencontre dans son adolescence avec des personnages devenus célèbres tels que Morik Brin venu à Alexandrie au début des années 20 est restée gravée dans son souvenir ; elle le décrit comme « antimilitariste » et « vibrant de foi socialiste ».
Après son baccalauréat, Daria connait une période de flottement entre littérature et peinture. Mais la rencontre avec Joseph Constant et son épouse Ida, va réveiller en elle la vocation d’artiste sculpteur. Inscrite initialement au cours de peinture dans cet atelier informel, rue Nebi-Daniel, elle découvre ce talent ignoré en modelant des visages, dont elle capte l’expression avec une ressemblance remarquable. Elle décide alors, avec l’accord de ses parents, d’aller à Paris apprendre la sculpture.
A Paris dés 1924, elle se présente à l’Académie de la Grande Chaumière sans autre formation préalable que les cours d’initiation de Constant. Les cours à la Grande Chaumière étaient libres, mais l’enseignement de la Grande Chaumière par Antoine Bourdelle il n’était pas fait pour les débutants. Daria suit aussi les cours de dessin à l’Académie Collarossi et l’enseignement d’André Lhote.
Antoine Bourdelle « était un être chaleureux, charamant. Il ne retouchait pas les sculptures. Il ne décourageait personne ». Daria suit les cours de la l’Académie de la Grande Chaumière de 1924 à 1927 dans le plus petit des deux ateliers avec Margareta Cossaceanu, Bella Raftopoulo, Alberto Giacometti, Germaine Richier, Jean de Marco, Pablo Curatella Manes, Otto Bänninger et d’autres.
Elle y rencontre aussi son futur mari, Imre Gyomaï, écrivain et journaliste, qui collabore alors à la revue Montparnasse. Imre a fui la répression de Horthy en Hongrie et a souffert en captivité dans les prisons sibériennes. Imre et Daria se marient à Alexandrie en 1926. Ils habitent à Paris, d’abord Villa Seurat, dans le 14ème arrondissement, ensuite Villa Junot (actellement Villa Léandre) à Montmartre, dans le 18ème arrondissement.
Le début des années 1930 est une époque très riche en rencontres avec des artistes et des écrivains, dont certains étaient aussi leurs voisins à Montmartre: Maurice Utrillo, Berthe et H.P. Grassier, Francisque Poulbot, Tristan Tzara, et aussi Roger Vailland et Bernard Lecache, rencontrés à La Boule Blanche, à Montparnasse. L’amitié avec Brassaï date de cette époque et elle a duré toute leur vie, ensuite avec Gilberte, son épouse.
Daria garde les liens avec son pays d’origine, l’Egypte. Elle retourne régulièrement pour y exposer ses œuvres. A cette époque, Le Caire connaissait une nouvelle effervescence culturelle et ambitionnait de devenir une scène internationale. La maison familiale Rue Ross, à Alexandrie, est toujours habitée par ses parents et elle y retourne pour traviller aussi ses sculptures lors de ses nombreux séjours.
A Paris, cette période fut aussi celle des « amours compliquées » et des « nostalgies déchirantes ». Les nouvelles inquiétantes venant des écrivains fuyant le stalinisme, les suicides et les disparitions derrière le rideau de fer, ont fini par jeter un effroi dans le groupe très cosmopolite qui fréquentait Montparnasse. Les grands mallheurs qui vont suivre annoncent déjà la fin d’une forme d’insouciance et de jeunesse des artistes.
A l’automne 1939, désormais séparée d’Imre, Daria perd sa mère, qui décède brusquement en France où elle sera entrée et Daria accompagne son père à son retour à Alexandrie. La guerre éclate peu après. Daria éprouve une grande angoissse face à ces boulversements. Elle craint d’avoit tout perdu et son retour en France est compliqué à cause de l’Occupation. Elle parvient néanmoins à y retourner et lorsque son père décède à son tour, en 1940 ou 1941, elle a une adresse à Toulon.
Au cours de cette période, Daria rencontre Georges E. Vallois dont elle deviendra la compagne durant plusieurs années. Il occupe des postes de Directeur au « Franc Tireur » , puis à « Libération ». Elle évolue dans le milieu de l’après guerre en cotoyant et en aidant d’anciens résistants. Dans « l’euphorie de la libération », elle acquière une grande maison à La Michelière, près de Honfleur, où les journalistes du Franc Tireur se réunissent quelques fois. Elle écrit :
« Sortis de la fange de la guerre… nous portions nos idéaux intacts, à bout de bras, comme offrandes au monde nouveau ».
Daria revient à Paris en 1950 et s’installe avec Georges au 11 Villa Spontini, où un étage de la maison est résevé pour son atelier. Mais, leur relation se gâte, l’argent vient à manquer et des divergences apparaissent avec Georges Vallois au sujet de la relation avec le pouvoir stalinien. S’en suit une longue période de profonde détresse morale.
« Vu trop de gens, le bruit des paroles m’a rendu sourde, je me suis dissoute au milieu de toutes ces rencontres, de ces contacts » écrit-elle. « Vivre de longues périodes avec ce désespoir au fond de soi » est son cri de détresse « Terreur de ne plus pouvoir travailler, d’avoir perdu le fil. Le travail c’est ma drogue ».
Mais l’artiste se ressaisit. Elle se reconstruit et se libère grâce l’écriture et à la sculpture. Elle écrit à nouveau ; c’est un roman inspiré de sa propre expérience, au titre étrange « Voyage avec une ombre » chez Calmann-Levy Editeur, 1957 sous le pseudonyme d’Anne Sarag. Ce livre parle de solitude et d’incompréhension dans un couple. Dans la sculpture, Daria retrouve ses premières révélations, son premier maître « qui [lui] a donné la connaissance, la révélation de l’univers des formes, de la pierre vivante, [son] plus vieil ami » c’est l’art égyptien, qu’elle a découvert à l’âge de douze ou treize ans à Abydos, au « royaume des mythes ». En 1958, elle expose à la Galerie Badinier à Paris, un ensemble de vingt et une sculptures sur le thème Bestiaires et hiéroglyphes, présenté par Waldemar George. Se trouvent en particulier des statues dénommées « Spectre, Orante, Vampire, Rhéteur, Prisonnier, Ange, Christ, Cri, Lémure, Démon, Gnome, Harpie, Chimère, Dictateur, Astronaute » ainsi que les bustes de Roger Vailland, Sacha Pitoëff, Charles Estienne et Jean Follain. Les critiques sont unanimes pour saluer son travail. « L’art de Daria Gamsaragan est tout en pensée, une spiritualité d’une haute envolée y domine » (D. Antranikian).
Pour Roger Vailland
« La recherche et les réussites de Daria Gamsaragan la situent au cœur de problèmes de l’art d’aujourd’hui. Là où les monstres du Guernica de Picasso se rencontrent avec les statuettes contre sort des sorciers de Bali, les oiseaux de Brancusi avec les pharaons-oiseaux des tombes de Louksor. Née en Egypte et nous formant à son tour à la lumière des métamorphoses, Daria Gamsaragan est éminemment de son siècle. Son œuvre en portera témoignage bien au-delà du siècle ».
Dans les notes manuscrites de Daria Gamsaragan, à la date du 26 Janvier 1955, il y a ce récit très particulier et très émouvant :
« Il y a des jours miracle, aujourd’hui a été pour moi un jour miracle, un de ces jours où la terre entière se donne à vous. Ce jour après cette longue nuit interminable. …Comment ce jour merveilleux m’a-t-il été donné ? La joie est venue d’une rencontre d’une simple rencontre, simple ? Comment appeler simple cette chose si rare, une vraie rencontre. Retrouver un ami, enfin un ami Giacometti et moi étions si heureux de nous retrouver si heureux que nous avons eu 20 ans pendant trois heures. Nous nous étions attendus pendant 20 ans. Cela valait la peine d’attendre. Comment expliquer cette compréhension totale l’un de l’autre, cet élan de l’un vers l’autre, cette communion formidable. Ce sentiment de retrouver un ami d’enfance. Nous ne nous lassions pas de communiquer de nous comprendre. Nous parlions ensemble, disions les mêmes choses, tout ce que l’un pensait, l’autre l’aurait pensé. A la fin j’ai eu peur, peur de quelque chose qui vienne gâter cette joie parfaite. Je voudrais que ça finisse pour que rien n’abime ce jour.
Ce jour qui n’est rien pour tous les hommes, qui courent dans la ville. Ce jour comment le garder comment faire pour que jusqu’au soir il ne s’effiloche pas… ».
Séparée de Georges Vallois, au début des années 1960, Daria s’installe square Henri Delormel à Paris, dans le 14ème arrondissement, au dernier étage, dans un duplex dont la mezzanine devient son atelier. C’est une renaissance. Sa production s’enrichit de nouveaux thèmes et se diversifie par son style et ses sujets. C’est une artiste épanouie. Elle participe à de nombreuses expositions.
Elle crée en 1966 un impressionnant monument à la sépulture des intellectuels arméniens au Cimetière de Bagneux (Hauts de Seine).
A partir de 1967 et jusqu’en 1982, l’artiste travaille pour la Monnaie de Paris et crée une quinzaine de médailles pour commémorer des personnages illustres, écrivains, philosophes, journalistes résistants. Daria a su leur donner un visage, un profil, un portait… qui nous touche par sa finesse sur l’avers des médailles, alors que le revers est tout un travail de recherche pour leur rendre hommage par une citation, une illustration de leur œuvre ou une représentation symbolique.
La carrière d’écrivaine de Daria se prolonge aussi avec un nouveau roman « L’anneau de feu » paru en 1965, Aux Editeurs Français Réunis. La critique littéraire accueille avec « beaucoup d’attention et de sympathie » la sortie de ce nouveau roman, en faisant aussi le lien avec la vie de l’artiste.
Membre pendant de nombreuses années du Pen-Club, Daria participe au congrès annuel en 1967, lorsque le Pen-club présidé par Arthur Miller, tient son congrès pour la première fois en Afrique, en Côte d’Ivoire. Les principaux thèmes sont centrés sur « l'analyse du mythe comme source d'inspiration dans les domaines de la littérature et des arts ». La politique n’est pas absente de ces débats, qui portent aussi sur la défense des écrivains emprisonnés dans différents pays.
Daria expose seule en 1970 à la Librairie Marthe Nochy (Librairie de Seine) des sculptures et des dessins ; « on découvre toute une collection de petits bronzes pleins de chaleur, traversés d’un souffle lyrique ». Pour Jeanine Warnod, ce sont « les petites sculptures élancées, femmes-flammes, oiseaux, figurines [porteuses] de cet élan mystique qui caractérise l’œuvre de cette femme sculpteur ». Les critiques sont là aussi très élogieuses pour cette exposition personnelle.
A début des années 1970, Daria travaille sur deux projets en relation avec la joaillerie : d’une part une commande de la maison Cartier à Genève pour une série représentant les douze signes du Zodiaque. En même temps elle a rencontré Coco Chanel qui lui demande de créer des croix, comme bijoux pour ses collections. Le décès de la créatrice de mode le 10 janvier 1971 met un terme à cette collaboration. Il subsiste néanmoins une série de dessins de ce projet.
A la fin de l’année 1972, pendant plus d’un mois, Daria fait un voyage découverte du Mexique invitée par un ami américain, entre Novembre 1972 et Janvier 1973. Elle passe le nouvel an au Mexique. Elle raconte dans un journal de voyage, destiné à devenir un projet de livre, les découvertes de cette civilisation ancienne dont elle décrit les monuments et des statues avec l’œil de l’artiste et analyse toutes les subtilités de ses représentations. Elle est totalement fascinée par ce voyage.
Le mensuel Armenia consacre son numéro d’Avril 1977 à la commémoration du « 1er massacre du XXème siècle ». En couverture, « les Crucifiés » de Daria et ensuite une longue interview réalisée par Henri Héraut, au domicile de Daria.
L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB en français ou AGBU en anglais) organise en Novembre 1982, à New York, en collaboration avec la Galerie Gorky à Paris (Galerie Basmadjian) une exposition collective d’artistes d’origine arménienne vivant en France ou ailleurs. Parmi les participants, à part Daria Gamsaragan, Carzou, Assadour, Jansem, Arto Tchakmakchian… Un grand nombre de statues de Daria y sont présentées, plus d’une dizaine, surtout ses dernières productions.
En 1984, une rétrospective de son œuvre est exposée à la Galerie Sculptures, Rue Visconti à Paris qui fut l’occasion de dérouler tout le cheminement de cette artiste dans son œuvre « riche en métamorphoses » comme le souligne Andrée Chedid dans la présentation. De nombreux articles saluent cet évènement. Pour l’artiste, le « cheval poisson » est le symbole de cette exposition : Daria le présente ainsi : « il lui avait fallu des siècles, des millénaires pour trouver la clef de mes songes, hanter mes nuits et jaillir enfin des flots, paré de sa crinière du Grand Vent ». Mais il y eu a aussi les bronzes du « Silence », des « Danseurs », du « Couple », des « Lianes », des « Guerriers du vent », de « L’oiseau des cavernes », du « Vol du Sagittaire », tant de « figures chargées de siècles et de légendes,… sculpture[s] du lyrisme hantée par les êtres mythiques … » (Nicole Duault, France Soir, octobre 1984). Daria Gamsaragan a participé par la suite à plusieurs expositions collectives à Paris.
Daria Gamsaragan est décédée le 1er Mars 1986 dans son sommeil à son domicile parisien.
|
|
Signatures de Daria Gamsaragan