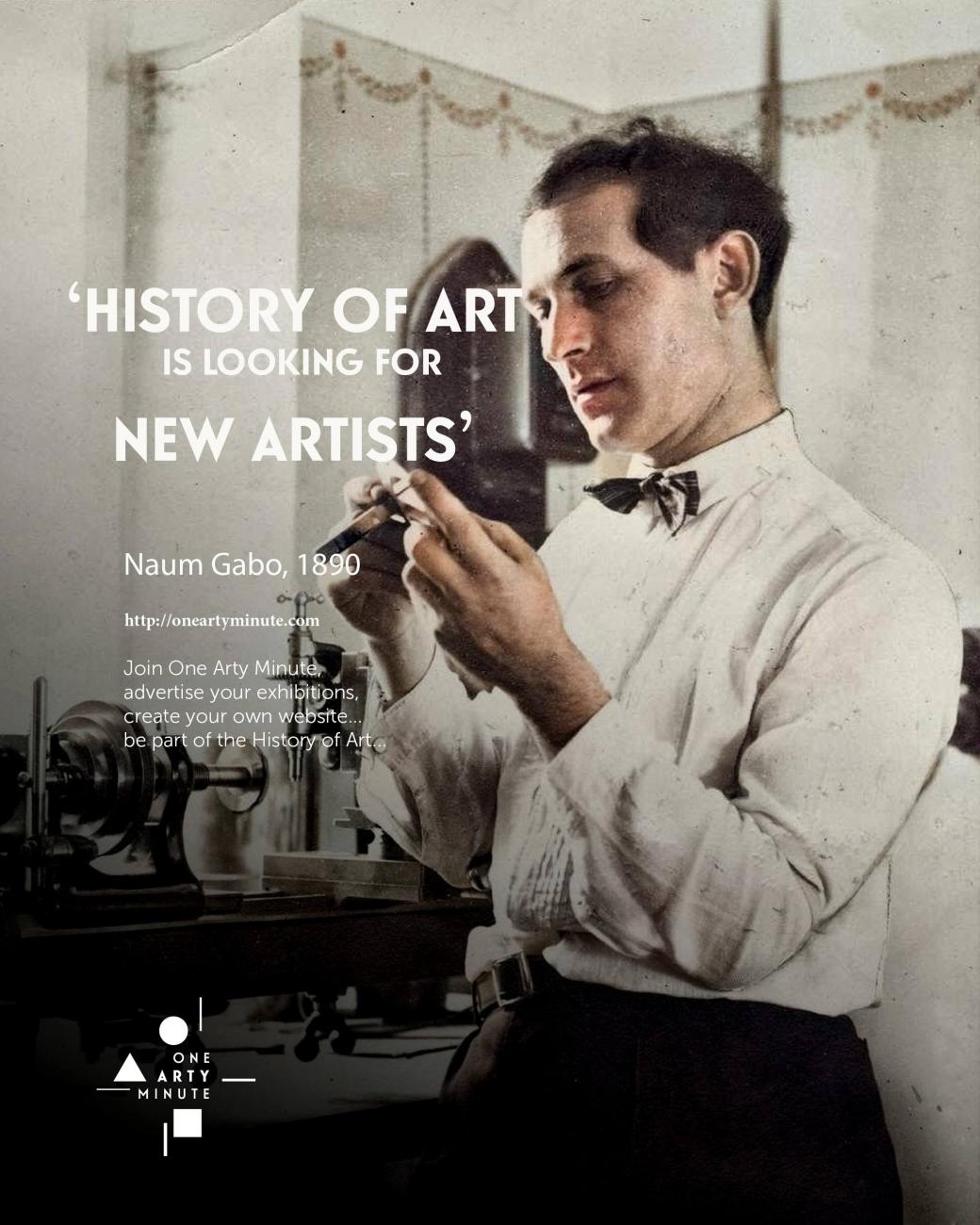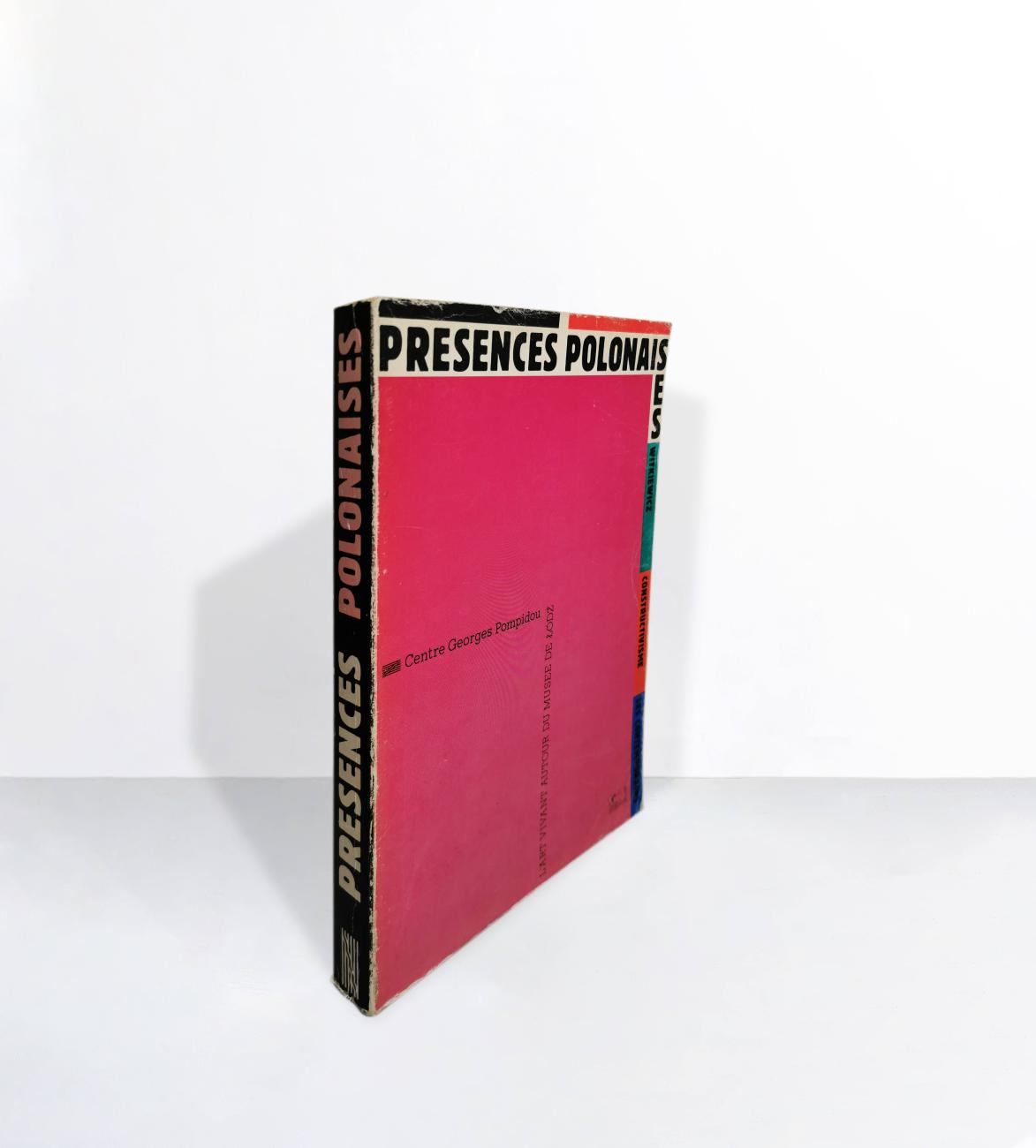Au-dessus des tempêtes de tous les jours, au-dessus des gravats et des décombres calcinés d'un passé ravagé, devant les portes d'un avenir vierge, nous proclamons aujourd'hui, pour vous, artistes, sculpteurs, musiciens, acteurs, poètes, vous tous pour qui l'art est non pas un simple prétexte à bavardages mais une source de véritables allégresse, nous proclamons : Verbe et Acte.
L'impasse où l'art est venu buter après ces vingt dernières années de recherches, doit être forcée. L'essor des connaissances humaines qui a pris naissance dès l'aube de notre siècle, essor qu'accompagne une pénétration irrésistible vers les profondeurs, hier encore mystérieuse, des lois universelles, l'épanouissement d'une nouvelle culture et d'une nouvelle civilisation suscitant un élan, sans précédent dans l'histoire, des vastes couches populaires vers la conquête des bienfaits de la nature, élan étroitement lié à l'expansion des peuples marchant vers l'union d'une humanité unique, et enfin la guerre et la révolution, ces orages purificateurs d'une ère qui s'ouvre, nous mettent devant le fait accompli des formes nouvelles de vie, nées déjà, et déjà agissantes.
Quel est l'apport de l'art à cette époque d'épanouissement de l'histoire des hommes ? A-t-il enfin les moyens indispensables à l'élaboration d'un grand style nouveau ? Ou suppose-t-il que l'ère nouvelle peut, aussi bien, ne pas posséder un style neuf ? Ou encore suppose-t-il que la vie nouvelle peut adopter une création qui prendrait appui sur les fondations du passé ?
En dépit des exigences de l'esprit régénéré de notre temps, l'art continue à se nourrir de l'impression, de l'apparences; il vacille à tâtons, du naturalisme au symbolisme, du romantisme au mysticisme. Les tentatives des cubistes, univers qu'une anarchie logique a fait voler en éclats, ne peut nous satisfaire, nous qui avons déjà fait la révolution, nous qui construisons, nous qui créons et qui édifions. On a pu considérer avec intérêt les expériences des cubistes, mais on ne peut les suivre ; car nous sommes convaincus que ces expériences ne touchent que la surface de l'art sans atteindre ses bases, convaincus que tout cela mène à la même graphie, au même volume, au même sens décoratif de la surface que dans l'art ancien.
En son temps, on a pu saluer le futurisme comme l'élan exaltant précurseur de la révolution, à cause de sa critique destructrice du passé, car rien d'autre n'aurait permis de prendre d'assaut ces barricades du "bon goût" - il y fallait de la poudre, beaucoup de poudre - mais on ne peut élaborer un système artistique à coups de phrases révolutionnaires. Il nous a suffi, sous les dehors brillants du futurisme, de découvrir son essence véritable pour nous trouver face à face avec l'éternel camelot, adroit et menteur, affublé des défroques élimées du patriotisme, du militarisme, du mépris de la femme et autres loques provinciales. Dans le domaine des fins de l'art, le futurisme n'est pas allé au-delà d'une tentative assez minutieuse cherchant à fixer sur la toile le réflexe optique, tentative qui déjà chez les impressionnistes s'était soldée par un échec. Il est clair pour tous que le simple enregistrement graphique d'une suite d'instantanés d'un mouvement figé ne peut recréer le mouvement lui-même. En fin de compte, l'absence totale d'un rythme linéaire fait d'un tableau futuriste quelque chose comme la circulation sanguine d'un cadavre. Le slogan grandiloquent de la vitesse était dans la main des futuristes l'atout majeur. Nous admettons pleinement l'éclat de ce slogan et nous comprenons qu'il ait pu renverser le provincial le plus râblé; Mais il suffit de demander au premier futuriste venu comment il se représente la vitesse pour qu'entre en scène l'arsenal complet des automobiles déchaînées, des gares tonitruantes, des fils de fer enchevêtrés, des cliquetis, des coups frappés, du vacarme, des sonneries, des rues tourbillonnante - est-il besoin de les convaincre que rien de tout cela n'est nécessaire à la vitesse et à ses rythmes ? Voyez le rayon du soleil : la plus silencieuse des forces silencieuses parcourt 300 000 kilomètres à la seconde. Notre ciel étoilé, quelqu'un l'entend-il ? Et pourtant , que sont nos gares en comparaison de ces gares célestes ! Que sont nos chemins de fer devant ces rapides de l'univers !
Non, tout ce bruit futuriste autour de la vitesse n'est qu'une trop évidente anecdote. Dès l'instant où le futurisme a proclamé que "l'espace et le temps sont morts d'hier", il a sombré pour nos dans les ténèbres de l'abstraction. Ni le futurisme ni le cubisme n'ont donné ce que le temps attendait d'eux.
En dehors de ces deux tendances artistiques, notre passé récent n'a rien apporté de bien déterminé, rien qui méritât l'attention. Mais la vie n'attend pas est la marche des générations ne s'arrête pas ; et nous qui assurons la relève de ceux que l'histoire engloutit, nous qui avons en mains la somme de leurs expériences, de leurs erreurs et de leurs réalisations, et avons vécu des années qui valent des siècles, nous disons : des nouveaux systèmes artistiques, aucun ne résistera à la poussée des exigences de la nouvelle culture en formation, tant que les bases mêmes de l'art ne seront pas assises sur le sol ferme des véritables lois de la vie ; tant que les artistes ne diront pas avec nous : Tout est mensonge, seule est réelle la vie et ses lois. Et dans la vie, seul celui qui agit est beau et fort et sage; seul il est dans le vrai. Car la vie ignore la beauté comme étalon esthétique. La réalité est la beauté suprême. La vie ne connaît ni le bien ni le mal, ni l'équité comme étalons moraux.
La nécessité est la plus haute et la plus juste des morales. La vie ne connaît pas, sur le plan de la raison, de vérité abstraite comme critère de connaissance.
L'action est la vérité la plus hâte et la plus sûre.
Telles sont les lois d'une vie inexorable.
Comment unu art fondé sur l'abstraction, sur l'illusoire, sur la fiction, ne serait-il pas broyé par les meules de ces lois ?
Nous proclamons : Pour nous l'espace et le temps sont nés aujourd'hui. L'espace et le temps : les seules formes où s'édifie la vie, les seules formes donc où devrait s'édifier l'art.
Les Etats, les systèmes politiques et économiques meurent sous la poussée des siècles ; les idées s'effritent, mais la vie est robuste ; elle croît et ne peut être arrachée, et le temps est continu dans sa durée réelle. Qui nous montrera des formes plus efficaces ? Quel grand homme nous donnera des fondations plus solides ? Quel génie concevra pour nous légende plus enivrante que ce récit prosaïque que l'on nomme la vie ?
La réalisation de nos perceptions du monde sous les espèces de l'espace et du temps, tel est le seul but de notre création plastique.
Et nous ne mesurons pas nos oeuvres au mètre de la beauté, nous ne les pesons pas aux balances de la tendresse et du sentiment. Le fil à plomb à la main, le regard précis comme une règle, l'esprit rigide comme un compas, nous construisons notre oeuvre comme l'univers construit la sienne, l'ingénieur un pont, le mathématicien ses formules. Nous savons que chaque objet à sa propre image. Une chaise, une table, une lampe, un téléphone, un livre, une maison, un homme : autant d'univers entiers avec leurs rythmes propres, leurs orbites particulières. Voilà pourquoi, lorsque nous représentons des objets, nous arrachons les étiquettes de leurs possesseurs, tout ce qui est accidentel et local, ne leur laissant que leur essence et leur permanence; pour manifester le rythme des forces qui se cachent en eux.
1. Nous répudions dans la peinture la couleur comme élément pictural. La couleur est le visage idéalisé et optique des objets. L'impression extérieure est superficielle. La couleur est accidentelle et n'arien de commun avec le contenu interne des corps.
Nous proclamons que le ton des corps, c'est-à-dire leur substance matérielle absorbant la lumière, est leur seule réalité picturale.
2. Nous refusons à la ligne sa valeur graphique. Dans la vie réelle des corps, il n'est pas de graphie. La ligne n'est qu'une trace accidentelle que l'homme laisse sur les objets. Elle est sans lien avec la vie essentielle et la structure permanente des choses. La ligne est un élément purement graphique, illustrait, décoratif.
Nous n'affirmons la ligne que comme direction des forces statiques cachées dans les objets, et de leurs rythmes.
3. Nous renions le volume en tant que forme plastique de l'espace. On ne peut pas plus mesurer l'espace en volumes qu'on ne peut mesurer un liquide en mètres. Considérez notre espace réel : qu'est-ce, sinon une profondeur continue ?
Nous proclamons la profondeur comme unique forme plastique de l'espace.
4. Nous renions, dans la sculpture, la masse en tant qu'élément sculptural. Aucun ingénieur n'ignore que les forces statiques des solides, leur résistance matérielle, ne sont pas fonction de leur masse. Exemple : le rail, le contrefort, la poutre, etc. Mais vous, sculpteurs, de toute tendance et de toute nuance, vous vous cramponnez toujours au préjugé séculaire qui voit une impossibilité à affranchir le volume de la masse. Voilà : nous prenons quatre plans et nous en faisons le même volume que nous ferions avec une masse de cent kilos.
Par ce moyen, nous affirmons en elle la profondeur, unique forme de l'espace.
5. Nous répudions l'erreur millénaire héritée de l'art égyptien qui voyait dans les rythmes statiques les seuls éléments de la création plastique.
Nous proclamons dans les arts plastiques un élément neuf : les rythmes cinétiques, formes essentielles de notre perception du temps réel.
Tels sont les cinq principes immuables de notre création et de notre technique constructiviste.
Sur les places et dans les rues, nous annonçons aux hommes d'aujourd'hui notre message ; sur les places et dans les rues, nous publions notre oeuvre, convaincus que l'art ne peut et ne doit demeurer le refuge des oisifs, la consolation de ceux qui sont las, la justification des paresseux. L'art est appelé à accompagner l'homme partout où s'écoule et agit sa vie infatigable : à l'établi, aux bureau, au travail, au repos et dans les loisirs ; les jours ouvrables et les jours de fête, à la maison et sur la route, pour que la flamme de la vie ne s'éteigne pas en l'homme.
Nous ne cherchons de justification ni dans le passé ni dans l'avenir. Nul ne peut nous dire de quoi sera fait l'avenir, ni à quelle sauce nous le mangerons. On ne peut pas ne pas mentir au sujet de l'avenir, mais on peut mentir à volonté. Et nous déclarons que toutes les vociférations concernant l'avenir n'ont pour nous pas plus de valeur que les larmes répandues sur le passé. Une nouvelle édition de la rêverie romantique ; un délire de moine sur le royaume céleste ; les premiers chrétiens en costume moderne. Celui qui aujourd'hui s'occupe de demain ne s'occupe de rien. Et celui qui demain n'apportera rien de ce qu'il a fait aujourd'hui, celui-là, l'avenir n'en a pas besoin.
Aujourd'hui : l'action. Les comptes, nous les ferons demain. Le passé, nous le laissons derrière nous, comme une charogne. L'avenir, nous le jetons en pâture aux chiromanciens. La journée présente, nous la gardons pour nous
Moscou, 5 août 1920.
N. Gabo
Noton Pevsner
2e Imprimerie d'Etat