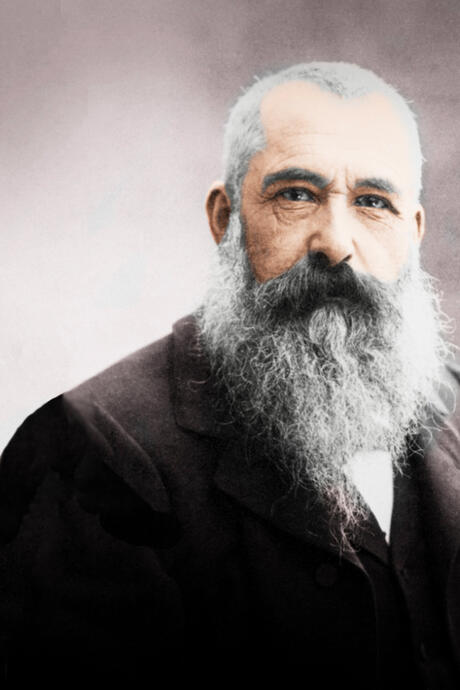Les personnes qui se rencontraient ainsi chez Charles Gleyre appartenaient à des catégories très diverses; C'était d'abord Sébastien Cornu, son ami d'enfance et Mme Cornu, femme du plus plus haut mérite et plus que personne capable d'apprécier l'esprit de l'homme et le talent de l'artiste ; Charles Nanteuil, qu'il avait connu à Rome ; Alexandre Denuelle, son compagnon de travail à Dampierre, et son frère Charles ; l'architecte Laval, avec qui il s'était lié à Venise ; Jules Duplan ; le père Enfantin, dont il fit un grand portrait qui, à ce que je crois, n'a jamais été achevé, et Félicien David, l'un et l'autre et des anciennes relations d'Egypte ; Edgard Quinet, Berlioz, Lanfrey, Emille Montégut, Flaubert, Jules Sandeau, Alfred de Musset, Hetzel, Peisse, Buloz, Millet, de Fontenay, Monfort et Lehoux, élèves de Géricault, qui l'avaient accueilli en Syrie ; Mérimée et Henri Martin, dont les conseils lui furent d'une grande utillité lorsqu'il exécuta son tableau des Romains passant sous le joug ; Juste Olivier, l'historien et le poète national du Canton de Vaud, et son beau-frère Louis Ruchet, aux efforts amicaux desquels il dut la commande, par le musée de Lausanne, de cet ouvrage ; Frtiz Berthoud, un autre de ses compatriotes, qui resta jusqu'à la fin de sa vie un de ses meilleurs et de ses plus fidèles amis ; le Dr Veyne, le Dr Thierry, Clément Caraguel, Taxile Delord, H. de la Madeleine, Laurent Jan , Ponsard, qui fit, dans l'atelier de la Rue du Bac, la première lecture publlique d'Agnès de Méranie. Gleyre s'était enthousiasmé de Lucrèce et avait même exécuté d'après des sujets empruntés à cette pièce deux ou trois charmantes esquisses dont l'une, qui représentait Lucrèce filant au milieu de ses femmes, à appartenu à M. Laurent Jan.
Puis venaient ses élèves de cette première période, toujours accueillis avec bienveillance par le Maître : Hamon, Gérome, Mazerolle, Ménier, Jobbé-duval, Picou, Aubert, Toulmouche, Nazon, Emile David, de Meuron, tanker, Heilbuth, Foulongne, Lejeune, Isambert, Dusssart, et quelques autres dont les noms n'ont pas surnagé.
Cependnant les hôtes les plus habituels de l'atelier étaient Charles Nanteuil, le seul de ses amis que Gleyre ait jamais autorisé à travailler près de lui, et Gustave Planche, revenu depuis peu d'Italie où il avait mangé en quelques années son petit patrimoine. Malgré son travail assidu à la Revue des Deux-Mondes, il était dans une extrême pénurie. Il avait adopté l'atelier de Gleyre et venait s'y installer presque tous les jours pour causer ou pour écrire ses articles. Il arrivait vers deux ou trois heure, vêtu de ce paletot sordide, de ce chapeau irisé, de ce pantalon de coutil qui avait été blanc, mimais dont on ne distinguait plus la couleur, qu'il portait hiver comme été et qu'on lui a vu tant d'années. Il tirait de sa poche un mouchoir à carreaux aussi sale que le pantalon avec lequel il époussetait gravement le fauteuil de cuir ; puis il essuyait son vaste front dénudé et s'asseyait lourdement. Gleyre connaissant ses habitudes lui roulait une vingtaine de cigarettes qu'il posait près de lui sur le haut tabouret et se remettait au travail. Cette société continuelle aurait lassé tout autre ; mais Gleyre avait connu Planche dans des temps meilleurs, il n'était pas homme à l'abandonner dans l'adversité. Il avait d'ailleurs pour lui une véritable affection où se mêlait un profond respect pour l'absolue probité du critique. Il l'aida beaucoup depuis cette époque jusqu'à sa mort. "Bien que réduit pour vivre au strict nécessaire, m'écrit M. Nanteuil, je ne l'ai jamais vu renvoyer un mendiant sans lui rien donner ; à défaut d'argent il donnait ses habits et sans lui Planche serait mort six ans plus tôt à l'hôpital. Tous les soirs il lui glissait dans la main de quoi dîner." Mes souvenirs confirment entièrement ceux de M. Nanteuil. Quelquefois le pauvre Gleyre n'avait pas la pièce de cent sous nécessaire à son ami; alors voyant Planche se lever, il s'approchait de quelqu'un de nous, lui touchait le coude. On comprenait ce petit manège qui se renouvelait souvent et on faisait passer aussi discrètement que possible dans sa poche ou dans sa main la bienheureuse monnaie. Alors il accompagnait Planche dans le corridor jusqu'au petit escalier, sans oublier de lui recommander de prendre garde à la demi-marche qui se trouvait au palier de la porte — recommandation qu'il faisait du reste à tous ses visiteurs — et il lui remettait le subside accoutumé. Hélas ! Je me souviens de la dernière fois que je vis ce pauvre Planche. Il avait un abcès sous le pied ; il nous conta qu'il venait de le percer avec un clou. Il boitait très bas et avait grand peine à se traîner. Nous nous récriâmes sur le danger d'un pareil traitement, et en le reconduisant jusqu'à la porte nous l'engageâmes, Gleyre et moi, de la manière la plus pressante à se soigner très sérieusement. A quelques jours de là, il mourait misérablement à la maison de santé Dubois d'un empoisonnement purulent.
Je ne veux pas oublier un personnage que l'on rencontrait aussi très fréquemment chez Gleyre et qui n'avait d'autres rapports avec Planche que sa pauvreté et son étonnante mémoire. C'est le nègre Joseph.
Il avait été admirablement beau. C'est lui qui avait servi de modèle à Géricault pour le noir qui, monté sur un tonneau dans le Radeau de la Méduse, fait des signaux de détresse et qui, bravant l'infection des cadavres que l'artiste avait rassemblés dans son atelier, était resté seul avec lui pendant la plus grande partie du temps que le peintre avait mis à exécuter cet ouvrage. Il savait sur Géricault et sur les autres peintres de cette époque une foule d'anecdotes qu'il racontait avec une verve intarissable. Depuis son enfance il n'avait manqué ni une revue, ni un enterrement de gens célèbres, ni une fête publique ; il ne pouvait entendre passer un régiment sans y courir, et malgré son âge on le rencontrait bien souvent à la suite des tambours avec les gamins, riant et gesticulant comme eux. Pour avoir ses entrées au théâtre il s'était fait claqueur et chantait Robert le Diable d'un bout à l'autre en imitant l'orchestre et les voix. Il avait vu tous les grands dignitaires de l'Empire qu'il contrefaisait de la manière la plus comique. Il savait les plus menus détails de leur histoire publique et privée et il se livrait avec Planche aux assauts d'érudition les plus divertissants. Il posait encore de temps en temps, et grâce à sa belle humeur il était bien accueilli dans tous les ateliers de Paris, dont il savait tous les cancans, ainsi que dans quelques bonnes maisons dont il avait séduit les cuisinières par les agréments de sa personne et de son esprit. Il était donc très bien nourri et son loyer ne lui coûtait pas cher. Mais lorsque je l'ai connu il se faisait déjà bien vieux ; l'ouvrage manquait souvent et il devint plus misérable d'année en année. Gleyre l'avait pour ainsi dire adopté, et pour lui donner le moyen de gagner quelque argent sans paraître lui faire l'aumône, il avait imaginé de le charger de nettoyer ses palettes.
Il y mettait le temps, et tout en faisant sa facile besogne il nous racontait des histoires à mourir de rire, dont il riait lui-même à gorge déployée. Il avait toute la gaieté et l'insouciance de sa race, et je n'ai jamais vu un homme plus heureux.
Les êtres humains n'étaient pas les seuls hôtes de l'atelier de Gleyre. Il adorait les bêtes. Il était membre de la Société pour la protection des animaux et, si timide qu'il fût, il n'hésitait pas à appeler un sergent de ville pour dresser procès-verbal à un charretier qui abusait du fouet. Quand il n'était pas par trop enfoncé dans ses rêveries, il ne pouvait passer près d'un chat couché sur le rebord d'une fenêtre, ou d'un cheval arrêté le long du trottoir, sans lui parler ou le caresser. Je retrouve dans mes plus anciens souvenirs l'image d'une magnifique chatte angora blanche avec les yeux bleus, dont nous admirions les poses indolentes et voluptueuses ; elle faisait ses ongles non seulement sur les meubles, mais sur les toiles, et il fallut bien finir par s'en séparer. Gleyre garda aussi pendant bien des années son singe Adam qu'il avait ramené d'Égypte et auquel il s'était tant attaché qu'il lui pardonnait les plus horribles méfaits. Ainsi ce singe avait dans le voisinage un ami singe comme lui. Les deux animaux se rendaient des visites. Un jour, Gleyre les trouva dans son atelier dont Adam faisait les honneurs à l'étranger. Ils étaient gravement assis tous les deux devant un portefeuille ouvert. Adam en tirait un dessin, le mettait sous les yeux de son confrère ; puis, quand il jugeait que celui-ci l'avait assez regardé il le déchirait et en prenait un autre. Si l'on ne fût intervenu, tout le portefeuille y aurait passé. Adam sortant par le châssis et descendant le long des gouttières et des murs faisait des promenades dans les cours et les jardins des environs. Dans une de ces excursions il fut rencontré par un gros chien qui lui cassa les reins. Gleyre essaya de le remplacer par un autre singe de cette même race au poil d'un brun verdâtre. Mais ce n'était pas son Adam, et il ne tarda pas à le donner à un de ses amis. Deux ravissants ouistitis qu'on lui avait envoyés ne réussirent pas davantage à le lui faire oublier. Il s'amusait pourtant beaucoup de leurs gentilles petites manières et les soignait avec une tendresse touchante. Il leur avait fait un lit d'étoupes et de ouate dans un coin de l'atelier ; il gardait son poêle allumé pendant la nuit à leur intention et ne manquait jamais en rentrant le soir d'aller remonter jusque sur leurs museaux et border leur couverture. Lui qui se privait de tout achetait en plein hiver pour ces bestioles le plus beau raisin qu'il pouvait trouver et qu'il payait jusqu'à 6 francs la livre. Les pauvres petits furent pris de rhumatismes et ne tardèrent pas à mourir. Il eut aussi un pigeon qui par un soir d'orage était venu battre contre son châssis. Il l'avait réchauffé et séché, et l'installa dans une petite loge ouverte à l'extérieur de sa fenêtre, où l'oiseau reconnaissant et parfaitement apprivoisé revenait pour manger et pour dormir. Un beau jour il ne revint pas. Était-il mort? Fut-il volage ? Quoi qu'il en soit, Gleyre regretta beaucoup celui que pendant longtemps il avait appelé son pigeon fidèle. En fait d'animaux il protégeait jusqu'aux souris. Son atelier en était infesté et sa femme de ménage, vieille avaricieuse qui soignait ses propres intérêts aussi bien que ceux de son maître et que nous nommions la mère rogne-beurre, avait résolu de détruire cette engeance. Pour avoir la paix, Gleyre feignit de la laisser faire. Tous les soirs elle tendait sa trappe, mais chaque fois que pendant la nuit Gleyre entendait tomber la porte de la machine il se levait au point du jour, mettait ses pantoufles, passait un pantalon et dans ce simple appareil, la trappe à la main, descendait furtivement l'escalier jusqu'au premier où il lâchait la pauvre bête. « Ces gens-là sont très riches, disait-il, ils peuvent bien nourrir quelques souris. Et puis j'ai joué un fameux tour à la mère rogne-beurre. »
La vie de Gleyre était alors, à peu de chose près, ce qu'elle fut plus tard et jusqu'à la fin. Il se levait entre sept et huit heures, s'habillait lentement en allant et venant dans son atelier, regardait son étude de la veille, donnait quelques coups de crayon au dessin commencé ou jetait rapidement sur un chiffon de papier ou sur une vieille enveloppe de lettre quelques pensées qui l'avaient préoccupé pendant la nuit. On a trouvé une foule de ces légers croquis, indications les unes informes les autres complètes et ravissantes de figures ou de compositions qu'il n'a jamais exécutées ou des variantes pour ses tableaux. Il allait déjeuner vers neuf heures ou neuf heures et demie. Qui ne l'a rencontré sur le trottoir de gauche de la rue du Bac, se dirigeant vers le café du quai d'Orsay où il arrivait l'un des premiers, rasant les maisons, un bras derrière le dos, la tête un peu penchée sur l'épaule et tellement absorbé dans sa rêverie qu'il fallait le toucher pour qu'il vous reconnût. Il prenait une tasse de café, un petit pain, un rond de beurre et allait ainsi jusqu'à sept heures du soir. Ce n'est que dans les dernières années que ses amis obtinrent, en faisant intervenir le médecin, qu'il joignit à cette trop maigre pitance un euf ou une côtelette. Mais au bout de quelque temps, il se lassait d'un régime qu'il trouvait trop substantiel, qui, à ce qu'il prétendait, l'empêchait de travailler, et il reprenait ses habitudes. Au café d'Orsay, il se plaçait tout au coin, le dos contre la fenêtre ; mais lorsqu'il était en veine de travail et qu'il voulait se ménager de longues journées, il allait au café Caron où l'on était plus matinal. Il lisait sept ou huit journaux et, très hostile au cléricalisme, il n'oubliait jamais l'Univers. « Il faut connaître ses ennemis, disait-il, et entretenir la haine. » .
Deux fois par semaine il allait à son atelier d'élèves, et les autres jours, lorsqu'il n'était pas obligé de se rendre chez quelque jeune artiste qui l'avait sollicité de venir voir son tableau pour lui donner un bon conseil et le tirer d'un mauvais pas, il était chez lui à onze heures. Quelquefois — bien souvent même - lorsqu'il ne se sentait pas cinq ou six heures devant lui, il ne faisait pas sa palette et de longues journées se passaient sans qu'il touchât un pinceau ou même un crayon. Il restait immobile, enfoncé dans ses pensées devant sa toile ou son dessin, et bien des personnes ont pris, pour une preuve de nonchalance ou de paresse, cette inaction et ces longues méditations silencieuses pendant lesquelles ses créations pittoresques se formulaient dans son esprit. Lorsqu'il avait un modèle il travaillait avec beaucoup de suite et d'ardeur. Il peignait toujours debout? et restait devant sa toile de onze heures jusqu'au crépuscule sans s'asseoir un instant pour ainsi dire et s'interrompant seulement de loin en loin pour allumer sa cigarette. Je le voyais presque tous les jours, soit au café où j'entrais pour savoir s'il y était encore, soit à son atelier où j'arrivais souvent avant lui. Je prenais sa clef chez le concierge et je l'attendais en lisant ou en regardant des dessins. Nous causions une heure ou deux; puis je retournais à mon travail. Sauf de rares occasions où quelque invitation nous empêchait l'un ou l'autre, nous nous retrouvions le soir à la Taverne anglaise de la rue Saint-Marc où nous dînions ensemble. Gleyre était d'une extrême sobriété. Il ne mangeait jamais que de deux plats et bien rarement un peu de fromage ou de fruit. Dans les temps de prospérité nous nous accordions une petite portion de laitues au jus dont nous étions tous deux très friands et qu'on préparait admirablement à la Taverne anglaise. Habituellement il ne buvait que de l'eau rougie, et ce n'est que lorsqu'il était avec quelques amis que, pour ne pas jeter du froid et par crainte de se singulariser, il acceptait un verre de vin pur.
Le soir nous faisions un tour de boulevard en fumant; puis il allait au divan Lepeletier dont il était un des fidèles et où se réunissaient, outre quelques habitués, les rédacteurs du National, dont les bureaux étaient au-dessus du café, et qui pendant toute la soirée apportaient des nouvelles. On était à la veille ou au lendemain de la Révolution de 1848. Les esprits étaient en pleine ébullition, et Gleyre était au nombre des plus excités d'entre nous. Il restait là causant et discutant jusqu'à onze heures ou minuit en prenant comme prétexte et pour se donner une contenance un petit verre d'eau-de-vie. Plus tard, à cause de ses yeux, toujours excessivement délicats, il dut renoncer à toutes liqueurs et se borner à un peu de café froid dans un grand verre d'eau. En retournant chez lui il passait au café de la Régence où il trouvait Alfred de Musset avec qui il faisait une partie d'échecs. Musset demeurait alors quai Voltaire; il le reconduisait, et, allant et venant le long de la Seine, les deux amis restèrent bien souvent à causer d'art et de poésie jusqu'à deux ou trois heures du matin.
Lorsque la maison où se trouvait le divan Lepeletier fut démolie, Gleyre se déshabitua peu à peu de traverser la rivière et il n'allait qu'assez rarement au café de Baden où s'étaient réfugiés quelques-uns des habitués du divan. Quand le temps était mauvais il mangeait dans un petit restaurant de la rue de Lille, nommé la Modestie, qu'il finit par adopter tout à fait, et où je le retrouvais souvent. Il passait ses soirées au café d'Orsay à lire les journaux et les Revues. Enfin, dans les dernières années de sa vie, l'une de ses nièces vint demeurer presque vis-à-vis de la maison où il habitait, dans le but de lui faire une famille, un foyer, et il dînait habituellement chez elle.
Gleyre aimait beaucoup la campagne. Il l'aimait non seulement en peintre, mais je dirai, en paysan. Il ne pouvait voir un champ de blé sans que ses souvenirs d'enfance lui revinssent, et il se préoccupait beaucoup de l'état des récoltes, des biens de la terre comme il disait. Dans la belle saison il allait souvent passer quelques heures et même faire des séjours dans les environs de Paris chez ses amis, Nanteuil ou Denuelle, et après notre promenade au Louvre nous nous échappions quelquefois le dimanche pour courir les bois et manger une friture de goujons à Bougival et au Bas-Meudon.
La révolution de 1848 apporta beaucoup de trouble dans la vie de Gleyre. Pendant bien des mois, l'atelier de la rue du Bac ne fut plus qu'une sorte de rendez-vous politique, et l'on n'y travaillait guère. Les uns y apportaient, les autres y venaient chercher des nouvelles, et tous discutaient avec une extrême ardeur les questions à l'ordre du jour. Gleyre avait toujours été républicain ; il avait accueilli avec enthousiasme la forme de gouvernement que s'était donnée un pays devenu pour lui une seconde patrie. On pourra suivre dans ses lettres de cette époque les agitations de son esprit qui passe rapidement d'une absolue confiance au plus profond découragement et presque au désespoir.